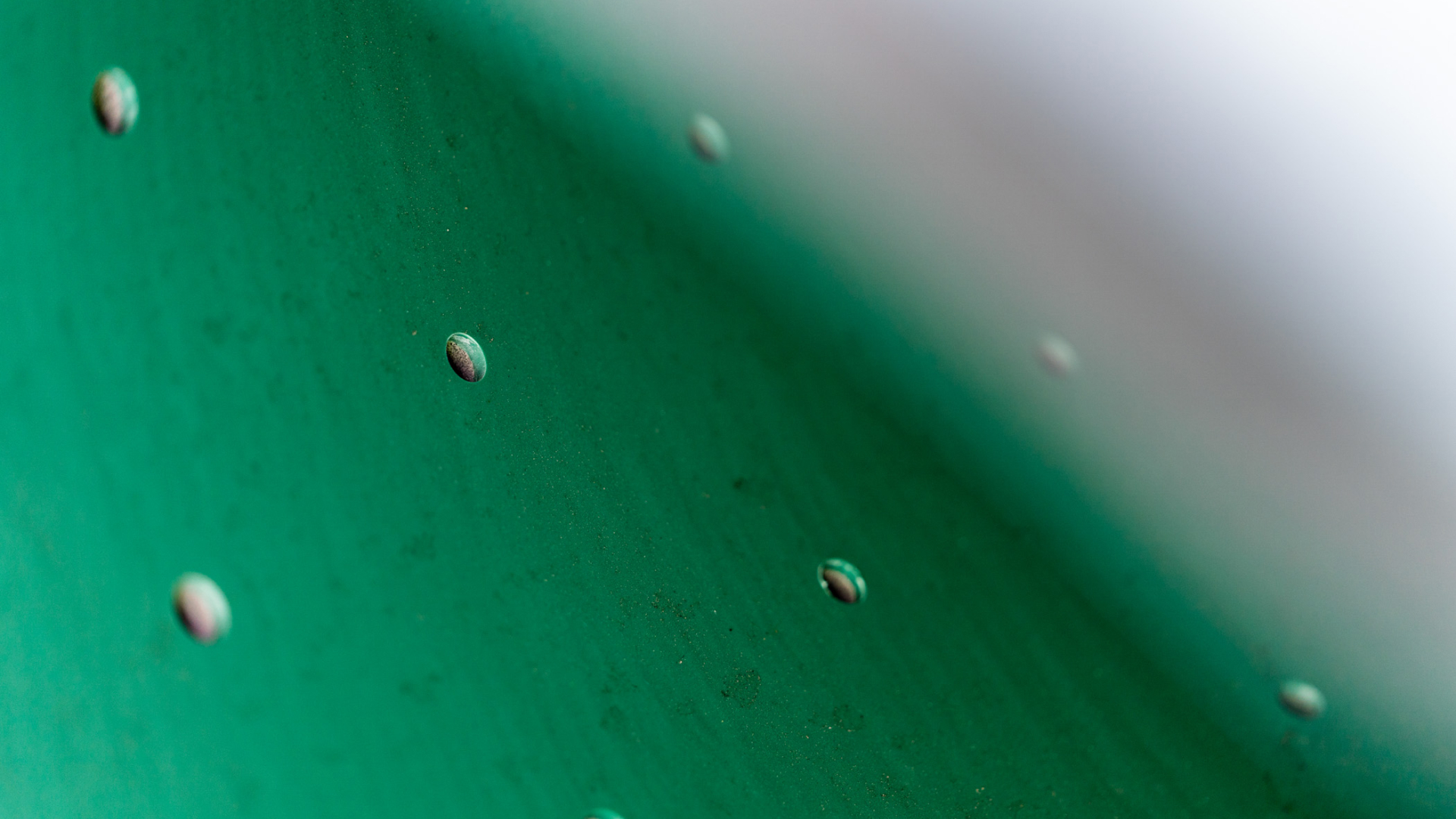Eau de pluie
La gestion de l’eau de pluie fait partie de notre ADN. Tous les jours, nous développons l’infrastructure d’une ville agréable à vivre, avec beaucoup de verdure et où l’on a les pieds au sec. En tant qu’experts en eau pour les espaces publics, les bâtiments industriels, les bâtiments utilitaires et tout ce qui tourne autour de l’eau de pluie dans le contexte de l’habitat, nous sommes les seuls à proposer un « plan de gestion de l’eau » pour l’ensemble du complexe, conformément aux réglementations locales. De la première goutte qui tombe sur le toit à l’infiltration dans le sol.
Gestion efficace de l’eau de pluie
Pour éviter les problèmes en cas de fortes pluies et, en outre, pouvoir utiliser efficacement l’eau de pluie pendant les sécheresses prolongées, il est nécessaire de mettre en œuvre des solutions de gestion de l’eau de pluie dès la phase de conception des projets. En prenant en compte l’ensemble du parcours de la pluie sur une parcelle, vous en assurez une gestion et une utilisation optimales !
Nous clarifions ce processus en divisant la gestion de l’eau de pluie en six étapes : collecter, transporter, filtrer, utiliser, infiltrer et stocker, et réguler. Nous vous aidons volontiers à gérer efficacement l’eau de pluie dans des installations nouvelles ou existantes
Les six étapes de la gestion de l’eau de pluie
Pourquoi choisir nos solutions de gestion de l’eau de pluie ?
- Nous concevons des solutions globales, de la collecte à l´utilisation.
- Notre département Engineering & Consultancy fournit une assistance et des conseils.
- Nous proposons une assistance sur site.
- Nos solutions sont également disponibles en tant que solutions préfabriquées.
- Nous fournissons de la documentation technique complète.
Vous voulez en savoir plus sur les solutions pour l'eau de pluie ?
Vous avez une question, ou vous souhaitez savoir quelle solution conviendrait le mieux à votre projet ? Laissez-nous vos coordonnées et nous vous contacterons !